XIV -
Emile DASSONVILLE - WIBAUX

Emile-Henry-Joseph DASSONVILLE,
fils d’Henry-Martial (Martial) Dassonville et de Justine Leplat est née à
Tourcoing le 20 janvier 1844.
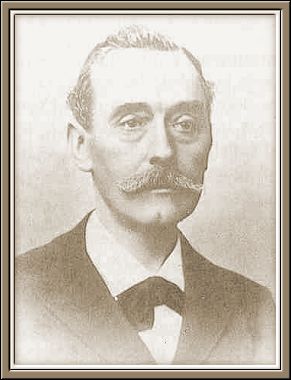
Emile Dassonville
1844 - 1902
En 1871, alors qu'il était âgé de 27
ans et encore célibataire, il se vit confier par son
père, la gestion de la nouvelle filature que ce
dernier venait de faire construire, à la
périphérie de Tourcoing, rue Notre-Dame des Anges.
Il dirigea donc cette usine flambant neuve, tandis
que ses parents poursuivaient l'exploitation des
établissements de la rue des Ursulines.
Emile se maria à Roubaix le 29 septembre 1873 et
comme le voulait la coutume de l'époque, il se
devait d'habiter le plus près possible de l'usine.
La jeune femme qu'il épousa, Pauline-Césarine-Marie-Joseph
WIBAUX, ne se formalisa pas, elle connaissait les
usages du milieu textile.
Pauline, née à Roubaix le 22 septembre 1850, était
la fille d’Henri-Hippolyte-Désiré-Joseph
Wibaux, fabricant de tissus, et de Marie-Catherine-Joseph
Parent. Elle était originaire de Roubaix et les
tissus fabriqués par sa famille jouissaient d'une
excellente réputation et décrochaient, à chaque
Exposition Nationale des Produits de l'Industrie, de
flatteuses médailles.

Pauline Wibaux
1850 - 1917
Les premières années de la vie du
jeune ménage furent endeuillées par la disparition
de Martial, le père d'Emile.
En 1885, la filature que gère Emile
Dassonville - Wibaux, Rue Notre-Dame des Anges, fait
tourner 13.128 broches de filature et 7.216 broches
à retordre (rassembler plusieurs fils en le tordant
afin d'obtenir un fil plus solide). Grâce au plan
cadastral et l'Etat de section de 1884, l'agencement
des bâtiments de la filature à la fin du XIXème
siècle n'a plus de secret pour nous.
En 1890, Tourcoing qui compte près de
65.000 habitants où l'industrie fournit des emplois
à plus de 16.000 personnes dont 12.000 dans la laine,
la tradition locale se maintient. Triage, peignage,
filature, teinturerie, tissage, fabrique de tapis,
toutes les étapes du travail de la laine sont
présentes dans la cité et attirent une nombreuse
main d’œuvre ouvrière en particulier de la
Belgique voisine. Nous retrouverons d'ailleurs bon
nombres de Dassonville descendants de la branche
belge pratiquants ces différents métiers.
Le recensement de 1886 précise que sur 57.621
habitants, on compte 20.976 belges !
Avec 12 filatures et 1.783 ouvriers, le
coton figure à la deuxième place derrière la laine,
loin devant avec ses 48 filatures et ses 6.887
ouvriers. Les Dassonville ne sont pas les seuls à
tenir le pari du coton dans un centre nettement
lainier, par contre bien peu d'entrepreneurs
tourquennois peuvent se vanter de l'avoir fait, comme
eux, de père en fils, sans interruption depuis 1806.
Les cotonnades tissées à partir des
filés de coton trouvaient facilement des débouchés
sur les marchés coloniaux protégés. En 1876 elles
représentaient 3,8 % des exportations de produits
manufacturés, en 1913 elles atteindront 10,6 %. Sur
le marché intérieur pendant les deux premiers tiers
du siècle, les tissus de coton furent le produit
vers lequel se porta en priorité la demande
supplémentaire due à la hausse des revenus. L'industrie
cotonnière nationale connut ensuite un
ralentissement, dans les années 1860-1890, largement
explicable par les accidents historiques déjà
évoqués : la guerre de Sécession, la guerre de
1870 et la perte de l'Alsace-Lorraine, mais aussi par
la grande dépression agricole. Le marché intérieur
retrouva heureusement tout son dynamisme à partir de
1890 et la confiance une fois revenue, les
industriels investirent à nouveau.
Les tendances du marché ne sont pas les
seuls soucis du milieu cotonnier dans lequel
évoluent les frères Dassonville. Le 1er mai 1890,
leurs usines sont désertées par le personnel. Leurs
ouvriers ont décidé comme quelques autres à
Tourcoing de suivre les directives de l'Internationale
Ouvrière qui veut faire du 1er mai 1890 une journée
de manifestations en faveur des huit heures au lieu
de onze à Paris et douze en province. Le 2 mai, les
usines restent fermées, on parle de plus de douze
mille grévistes dans la seule ville de Tourcoing et
environ 500 soldats cantonnent dans la ville, ils y
demeureront jusqu'au 17 mai lorsque les ouvriers
auront tous repris le chemin de l'usine. .......
En 1890, la totalité des parts de la
famille fut alors rachetées par deux jeunes gens,
âgés respectivement de 22 et 20 ans, Ludovic et
Joseph Legrand avec lesquels Emile s'associa pendant
quelque temps. Ensemble ils constituèrent une
nouvelle société, une autre histoire commença qui
bientôt ne concernera plus la famille
Dassonville. La main passe ... mais la vie continue.
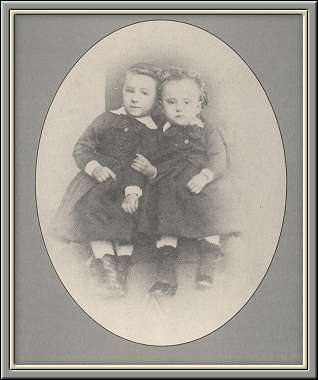
Ludovic (1868-1911) et Joseph
Legrand (1870-1932)
Archives de la famille Dassonville
Ludovic et Joseph Legrand étaient tout
simplement ses neveux, du côté de sa femme Pauline
Wibaux. Ludovic avait trois ans et Joseph un
peu plus lorsque leur mère Marie-Catherine Legrand,
née Wibaux décéda à l'âge de 24 ans. Trois ans
plus tard, leur père Louis Legrand, disparaissait à
son tour dans sa 29 ème année, les laissant
orphelins. Le grand-père des bambins, Auguste
Legrand pouvait difficilement les accueillir. Veuf,
cet ancien magistrat lillois, homme d'une grande
pitié, avait reçu la prêtrise et se consacrait
entièrement à son sacerdoce. La famille Wibaux
entoura les deux enfants et plus particulièrement la
soeur cadette de Marie-Catherine Legrand, Pauline
Wibaux, l'épouse d'Emile Dassonville. En leur
offrant le rachat de la filature en 1890, Emile leur
mettait le pied à l'étrier après avoir pourvu à
leur éducation tout au long de leur enfance et de
leur adolescence. L'héritage de leurs parents
permettait aux deux frères de réaliser cette
opération et leur avenir paraissait assuré. L'évaluation
de la filature de la rue Notre-Dame des Anges avec
tout le matériel, le terrain et cinq maisons
ouvrières se montaient à 350.000 francs et
faisaient tourner 16.250 broches de filature et 4.432
broches à retordre les fils pour le tissage. C'était
une filature de taille moyenne.
L'achat se fit et le 28 juin 1890, une société en
nom collectif était constituée pour quinze ans
entre les frères Legrand et Emile Dassonville-Wibaux,
leur oncle. La raison sociale fut : "Legrand
frères et Dassonville". Les bénéfices et
pertes se répartirent de la façon suivante : 75 %
à Ludovic et Joseph Legrand, 25 % à Emile
Dassonville qui avait le droit de prélever sur les
bénéfices mille francs par mois.
Les deux jeunes gens manifestèrent à
Emile et Pauline leur reconnaissance en leur laissant
la jouissance de la maison attenant à l'usine et en
gardant leur oncle comme Directeur de la filature.
Un an plus tard, branle-bas de combat !
Emile quitte la société. Le 13 avril 1891,
résiliation du bail de location des frères Legrand
à la société et le 15 avril 1891, la société
Legrand frères et Dassonville est dissoute et une
nouvelle société en nom collectif constituée.
Pourquoi Emile s'est-il retiré ? Un
désaccord à propos de l'agrandissement projeté ?
Peut-être. A moins qu'il n'ait préféré laisser le
champ libre à ses neveux, rassuré sur leurs
compétences, après les avoir vus à l'oeuvre
pendant un an.
Après le départ d'Emile, une page est
tournée, l'histoire des Dassonville se
poursuivra ailleurs, à Tourcoing, rue de l'épine (voir
Léon
Dassonville)
De ce long épisode de 85 ans des
filatures Dassonville, "fondateur" de l'histoire
de "LA BLANCHE PORTE", demeurent aujourd'hui
deux témoins marquants : les bâtiments de filature
et la maison qu'occupèrent, durant plus de vingt ans,
Emile et Pauline Dassonville - Wibaux, rue d'Austerlitz.
L'usine de La Blanche Porte
commercialisera vêtements, bonneterie ... mais
surtout du linge de maison "du blanc", dont
le slogan fut "de notre usine à votre lit".
Elle se spécialisera ensuite dans la vente par
correspondance concurrençant les usines de "La
Redoute" et celles des "Trois suisses".
En 1924 La Blanche Porte alimentera 500 dépôts en
France et ne limitera pas son ambition au seul
marché national. Elle exportera également en
Afrique du Nord, en Argentine, en Uruguay, à la
Réunion ....
En 1927, son fichier clients comptera 45.000 adresses
et 83.000 en 1931.
Vous pourrez lire la suite de l'histoire
de la Blanche Porte dont les Dassonville sont à
l'origine dans le livre de Martine Le Blan "Histoire
de La Blanche Porte depuis 1806" (1991).
Emile décédera à Tourcoing, le 2
octobre 1902, et Pauline également à Tourcoing, le
18 mai 1917
1 - Emile-Martial-Alexis-Joseph
DASSONVILLE, né à Tourcoing le 28 juin 1874.
2 - Martial-Aimé-Marie-Joseph DASSONVILLE,
né à Tourcoing le 24 juillet 1876 fut représentant
de commerce. Il épousa à Roubaix le 17 janvier 1905,
Jeanne-Marie-Joseph SALEMBIER, fille de Jean-Baptiste-Louis-Hyacinthe-Joseph
Salembier, receveur municipal de Roubaix et de Elise-Pauline-Marie-Joseph
Goube, née à Roubaix le 29 novembre 1883. Elle fut
infirmière major de la Croix-Rouge française,
décorée de la médaille d’argent des
épidémies.
Région du Nord
Place du Touquet
PARIS-PLAGE
Proposition, concernant Madame
Dassonville pour une médaille d’argent.
« Evacuée des régions envahies,
a donné les soins les plus dévoués aux blessés de
l’infirmerie de gare d’Etaples, depuis le
début de la guerre. Affectée à l’H. C. 35,
depuis le 20 novembre 1914, rend d’éminents
services aux blessés par ses soins éclairés, sa
douceur de caractère, leur rappelant bien souvent
leur mère. A soigné des contagieux. A contracté
une pleurésie sèche, le 20 février 1916 dans l’exercice
de ses fonctions.
Paris-Plage , le 10 octobre 1917
Le Médecin-Major de 1er classe, P. F
Martin,
Médecin en chef du service de Santé de la Place
a - Jean-Marie-Joseph DASSONVILLE,
né à Roubaix le 29 novembre 1905, épousa Jenny
FAINON. En 1962, ils habitaient La Madeleine (Nord).
aa - Janine DASSONVILLE
b - Claire- Marie-Joseph DASSONVILLE,
née à Roubaix le 28 février 1907, qui épousa Louis
ADAM.
aa - Marie-Claire ADAM qui
épousa Robert DUPREZ, fils de Robert et de
Germaine Sartorius. Robert Duprez (père) épousa en
secondes noces Marguerite Dumortier petite fille de
Marie-Hortence Dassonville - Corman qui était veuve de Marcel
Duprez, frère de Robert. Marguerite Dumortier était
la petite fille de Marie-Hortence Dassonville. Par ce
remariage, Marguerite Dumortier devint la belle-mère
de Robert (fils). Le couple habite Wasquehal (Nord).
aaa - Patricia DUPREZ, épousa Eric
VAN de PUTTE fils de … Descheemaeker
et ils habitent Bondues (Nord).
aaaa - Natacha VAN de PUTTE
bbbb - Katia VAN de PUTTE
cccc - Nicolas VAN de PUTTE
bbb - Caroline DUPREZ
ccc - Sophie DUPREZ
ddd - François DUPREZ
